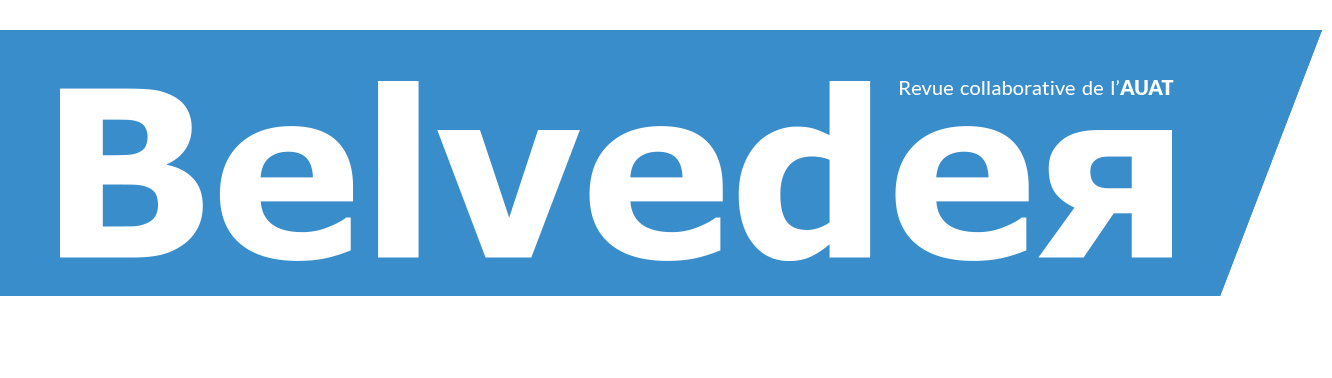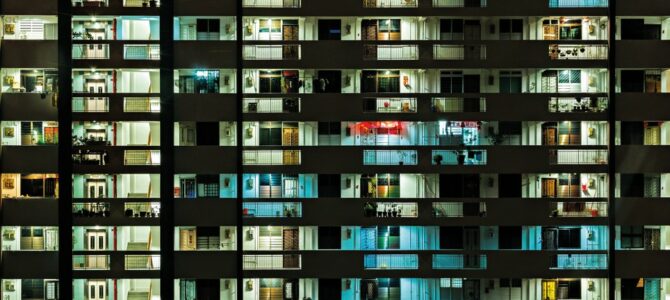
Téléchargez l’article au format PDF
Olivier BOUBA-OLGA
Chef de service Études, prospective et évaluations à la Direction de l’intelligence territoriale, de l’évaluation et de la prospective, Région Nouvelle-Aquitaine
Dans leurs documents de planification, la quasi-totalité des territoires pensent leur développement futur en tablant sur des hypothèses démographiques optimistes. La population du territoire a diminué ou est restée stable sur la période précédente ? Alors on va supposer qu'elle va se mettre à augmenter. Elle avait augmenté ? On considère alors que cela va continuer, voire s'accélérer.
Cet optimiste découle sans doute pour partie du volontarisme des élus, qui pensent que leur action compte, qu’elle peut inverser des tendances négatives ou renforcer des tendances positives. Et c’est tant mieux ! On ne peut guère souhaiter que les élus considèrent que leurs actions ne servent à rien. Il résulte aussi du fait que les dotations des collectivités locales dépendent du nombre d’habitants : un territoire dont la population augmente, ce sont des ressources en plus ; un territoire dont la population baisse, ce sont des ressources en moins. L’objectif premier des politiques locales est donc de faire en sorte que la population augmente, pour dégager des ressources supplémentaires et faire face à des besoins potentiellement illimités. Sans doute s’explique-t-il également, plus généralement, par le poids de l’histoire de pays en croissance depuis plus de deux siècles, qui se sont organisés dans ce cadre et peinent à raisonner autrement.
Pourtant, on peut être sûr d’une chose : si presque tous les territoires parient sur une hausse de leur population, beaucoup de paris seront perdus. Pour preuve, on peut d’abord s’en remettre aux projections de l’Insee, qui permettent d’estimer les populations départementales futures sur la base de différents jeux d’hypothèses sur les taux de natalité, les taux de mortalité et les migrations. Dès 2030 (demain matin, donc), dans le scénario central, 41 départements voient leur population diminuer par rapport à 2018, et pour 3, le nombre d’habitants est inchangé. Pour 44 départements, donc, le pari d’une croissance de la population a toutes les chances d’être perdu. Chiffre qui augmente si l’on table sur un scénario avec fécondité basse, plus en phase avec les évolutions récentes, 3 départements supplémentaires voyant alors leur population baisser à horizon 2030. Bien sûr, il s’agit de projections. L’avenir reste ouvert, il est possible que les évolutions soient autres, si certains paramètres bougent. Au passage, signalons qu’un paramètre pourrait faire sensiblement bouger les choses : l’immigration. Mais on ne peut pas dire qu’il s’agit de la piste la mieux travaillée en France sur les dernières années, tant le sujet est instrumentalisé par les uns et tabou pour d’autres.
Le mantra de l’attractivité
Plutôt que de regarder devant, on peut regarder un peu en arrière. Concentrons-nous sur les données des recensements de la population de 2011 et 2022, au plus fin à l’échelle des communes, dans leurs contours de 2024. Sur cette période d’un peu plus de 10 ans, autour de 16 000 communes (sur près de 35 000) ont connu une baisse de leur population, soit 45 % de l’ensemble. À l’échelle des intercommunalités, 518 sur 1 251 sont dans ce cas, soit environ 41 %. Nul doute que la plupart de ces territoires avaient planifié leur développement en tablant sur une hausse de la population, et qu’ils ont continué ainsi.
Nombre d’acteurs des territoires ont connaissance de ces chiffres. Pour autant, ils ne modifient pas leurs hypothèses. Pourquoi ? Car chacun pense qu’il va pouvoir tirer son épingle du jeu, fusse au détriment de ses voisins, proches ou lointains. Si les migrations internationales ne sont pas envisagées, la plupart tablent sur des migrations infranationales : les plus grandes villes parient sur un présupposé avantage métropolitain, pourtant contestable[1], les territoires ruraux et les villes moyennes sur un exode urbain, tout aussi contestable[2], les régions de l’Ouest et du Sud sur la poursuite de l’héliotropisme et de la littoralisation, les territoires de l’intérieur sur le recul du trait de côte, les régions de toute la partie Nord sur la remontée des populations à la suite du dérèglement climatique… La population française devrait baisser d’ici 2044 selon l’Insee[3], le solde naturel dès cette année[4], mais chaque territoire pense qu’il y échappera. Nous sommes proches d’un jeu à somme nulle où il s’agit, pour gagner, que les autres perdent, jeu qui pourrait rapidement devenir à somme négative, dès lors que la population diminue, où il ne s’agit même plus de gagner, mais de moins perdre que les autres. C’est déjà le cas s’agissant de santé, compte-tenu de la démographie médicale, ou d’écoles, vu la démographie scolaire.
Comment faire pour gagner à ce jeu collectivement délétère ? En pariant sur l’attractivité. Soit vis-à-vis des entreprises, qui vont créer des emplois et donc attirer les personnes susceptibles de les occuper (people follow jobs), soit en attirant directement des habitants, si possible des familles avec de jeunes enfants (pour sauver les écoles) et à hauts revenus, pour que leurs dépenses alimentent le commerce local (jobs follow people). Attirer des entreprises, d’où la volonté d’aménager des zones d’activité. Attirer des ménages, d’où celle de développer des lotissements. Mais rares sont les territoires désireux d’accueillir des personnes âgées ou des personnes pauvres, dont il faudra bien s’occuper, pourtant, et dont le nombre va croissant.
Changer d’obsession
Ce jeu est intenable. Même si la population augmentait, il serait intenable, car on se heurte à un autre mur, non plus démographique, mais écologique. Le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité nous obligent à penser autrement notre avenir. Il est donc indispensable de changer d’obsession. Il ne s’agit plus d’être obsédé par la croissance de sa population, en misant tout sur l’attractivité, exacerbant ainsi la concurrence territoriale, mais d’être obsédé par ce que nous proposons de nommer l’habitabilité territoriale[5] : comment assurer le bienêtre de tous les habitants dans le respect des limites planétaires ? Comment faire en sorte que tous les habitants puissent se loger, se nourrir, se déplacer, accéder à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’emploi…, ceci en développant des réponses compatibles avec l’indispensable préservation de l’environnement ?
Ce n’est pas en aménageant toujours plus de zones d’activité économique, de zones commerciales ou de bureaux, ni en développant toujours plus de lotissements, en creusant, creusant, creusant, qu’on y parviendra. Partons plutôt des besoins des populations et interrogeons-nous, à chaque endroit, sur notre capacité à y répondre, de façon compatible avec l’impératif environnemental, en combinant technologies (présentes et futures) et sobriété[6]. Pour les mobilités, par exemple, on sait que la solution passera par le déploiement de la voiture électrique et de véhicules intermédiaires, l’accroissement du report modal (au profit des transports en commun, du vélo, de la marche) et du taux de remplissage (covoiturage, autopartage), ainsi que par des réflexions sur l’organisation de l’espace afin de réduire autant que faire se peut le volume global de déplacements.
Et ce, avec un mix de réponses variable selon les endroits, car la nature et l’intensité des enjeux varient d’un territoire à l’autre, d’où des enjeux complémentaires de production de connaissance (quelle est la nature et l’intensité des problèmes locaux ?) et, par suite, de différenciation locale de l’action. Pour chaque sujet à traiter, il convient d’identifier l’ensemble des réponses possibles, en se nourrissant pour cela de ce qui s’invente sur les territoires, car les initiatives locales ne manquent pas. Sans doute conviendrait-il aussi de s’interroger sur des innovations en matière de finance locale : tant que les financements dépendront du nombre d’habitants, l’incitation à la croissance de la population restera la plus forte. Favoriser les financements décorrélés de cet indicateur nous semble donc essentiel. Pour éviter la concurrence territoriale, il conviendrait aussi de développer des incitations à la coopération : pour tout un ensemble de sujets, en effet, les solutions les plus pertinentes passeront par le déploiement de réponses interinstitutionnelles et interterritoriales, et ce sont elles qui permettront de répondre aux besoins de manière plus sobre.
Partir d’une analyse des besoins fondamentaux de l’ensemble des habitants, couvrir ceux qui ne le sont pas, grâce à des réponses adaptées et coordonnées, justes socialement et soutenables du point de vue environnemental : tel est l’enjeu, que la population augmente, stagne ou diminue.
[1] Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, « Le récit métropolitain : une légende urbaine », L’Information géographique, vol. 83, pp. 72-84, 2019/2.
[2] Coline Bouvart et Olivier Bouba-Olga, « Exode urbain : une mise au vert timide », La note d’analyse de France Stratégie, n° 122, pp. 1-8, 2023/7.
[3] Élisabeth Algava et Nathalie Blanpain, « 68,1 millions d’habitants en 2070 : une population un peu plus nombreuse qu’en 2021, mais plus âgée », Insee Première n° 1881, 2021.
[4] « En France, le nombre de décès risque de dépasser celui des naissances en 2025, une première depuis 1944 », Le Monde, 25 juillet 2025.
[5] Olivier Bouba-Olga, « Habitabilité territoriale : comment concilier bienêtre de tous et respect des limites planétaires ? » Fondation Jean-Jaurès, avril 2024.
[6] Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, « Les incidences économiques de l’action pour le climat : rapport à la Première ministre », France Stratégie.